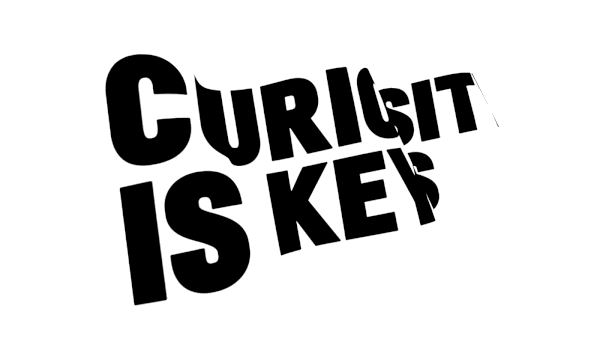Pour réintégrer la biodiversité dans l’espace urbain, reconnecter population urbaine et nature, manger mieux ou réduire l’impact des villes sur l’environnement, le levier de l’agriculture urbaine semble prometteur. Mais parce que le développement urbain a, des décennies durant, relégué l’agriculture à l’extérieur de ses frontières, parce que le bâti a peu à peu grignoté l’espace foncier au sol et parce que les acteurs même de l’aménagement ne sont pas coutumiers des enjeux de production agricoles, les défis sont immenses. Les fermes ne pourront prendre une place pérenne en ville qu’à condition de changements de paradigmes immobiliers, économiques, territoriaux et sociaux.
Etat des lieux et perspectives.
Pas de doute l’agriculture urbaine a le vent en poupe. Les projets fleurissent dans toutes les grandes villes du globe, sur tout type d’espaces — des toits d’entreprises ou d’hôpitaux aux pieds d’immeubles d’habitations en passant par les cours d’écoles, les jardins partagés ou les friches industrielles — et sur toutes surfaces de quelques dizaines à quelques milliers de m2. Rien qu’à Paris les deux appels d’offres Parisculteurs de 2016 et 2018 ont permis de lancer 80 projets.
Son succès, l’agriculture urbaine le doit aux services écosystémiques qu’elle rend. Citons notamment la rétention des eaux de pluie, la diminution des ilots de chaleur, ou la captation du carbone par les plantes. Services auxquels s’ajoutent des « externalités positives » en termes d’éducation à la protection de l’environnement et à une meilleure alimentation, de reconnexion des citadins à la nature, de réinsertion ou encore de création de lien social. Sans parler de son impact sur les paysages urbains.
Aux premières recherches et expérimentations isolées ont donc succédé de multiples études scientifiques, le déploiement de pratiques agricoles variées et innovantes, et la naissance d’un écosystème pluridisciplinaire sur le sujet.
Rarement issues du monde agricole, les entreprises spécialisées se sont multipliées, à l’instar de Topager, Merci Raymond, Cycloponics, Agricool, Peas & Love, Refarmers, CultiCime, Aéromate, Bigh ou encore Lufa Farms. Eparpillé au départ, ce nouveau monde professionnel, se structure petit à petit. C’est ainsi qu’est né en 2016 l’AFAUP, l’Association Française d’Agri-
culture Urbaine Professionnelle, la première association nationale regroupant à l’échelle d’un pays les acteurs du développement de l’agriculture en ville.

Dans cet élan, les institutions de recherche, comme Agro ParisTech ou l’INRA en France, ne sont pas en reste. Lancé en 2018, Refuge, programme de recherche-action mené conjointement par Agro ParisTech et l’INRA, est voué à produire des outils d’aide à la décision pour les collectivités territoriales, gestionnaires, aménageurs, décideurs publics, comme les porteurs de projet d’agriculture urbaine (privés et associatifs). Il propose notamment une méthodologie d’évaluation et de gestion des risques sanitaires liés à la présence potentielle d’Eléments Traces Métalliques (ETM) dans les sols des fermes urbaines.
Quel rôle pour les acteurs traditionnel de l’immobilier
et de l’aménagement urbain ?
Cependant, intégrer ces projets agricoles urbains de manière pérenne « présuppose une nouvelle manière de fabriquer l’urbain et l’agricole qui repose non plus sur une juxtaposition des projets mais sur une reconnexion de type spatiale et fonctionnelle », avertit Véronique Saint-Gès, économiste à l’Inra, dans un article publié sur le site construction21.org.
Une reconnexion que doivent avoir à l’esprit les aménageurs, promoteurs et investisseurs immobiliers et à laquelle ils devraient donc prendre part. Comment et à quel prix ? Voilà les questions.
Car se lancer dans des projets immobiliers d’agriculture urbaine ou l’intégrant en partie, c’est allouer les surfaces autrement, renoncer à des gains fonciers et locatifs bien supérieurs quand on parle de bureaux et de logements par exemple.
« Chez Keys AM, nous sommes convaincus qu’il y a un intérêt très fort à la production alimentaire en ville, de manière locale et saine. Produire au plus près des consommateurs, c’est en effet réduire l’impact carbone lié à l’approvisionnement notamment (réduction massive des distances parcourues), mais aussi garantir une grande qualité nutritive (en proposant des produits ultrafrais). Les raisons sont simples : faire parcourir du chemin aux décisionnaires politiques, acteurs de l’immobilier et citoyens sur l’impact carbone de nos cités aujourd’hui, et participer à la construction de villes durables, confie Antonin Baigts, Directeur Asset Developpement. Et d’un point de vue investisseurs, nous sommes capables de contribuer à l’agriculture urbaine à deux titres. Soit avec une casquette « private equity » en prenant des participations dans des sociétés disruptives en la matière. Soit avec notre casquette d’investisseur immobilier classique.
Dans ce cas, c’est plus complexe car cela demande d’être présent très en amont du projet. Plus on arrive plus tard, plus le prix immobilier est élevé. Et l’agriculture urbaine paye un loyer, si ce n’est proche de zéro, en tous cas très faible, avec une montée en charges et des équipements assez importants à mettre en place. En réalité, si la collectivité ou l’aménageur est persuadé de la pertinence de l’agriculture urbaine et porte, en ce sens, une partie du risque financier en assurant des charges foncières moins élevées, alors les chances de développer des projets agricoles en ville viables s’accroissent ».
Avant même de mettre au point un projet viable, à même de réattirer les activités productives en ville et de raccourcir les circuits alimentaires, l’idée est donc d’avancer l’intérêt général et une construction porteuse de sens avec des acteurs prêts à gagner moins d’argent sur la vente de leur terrain. Et à cet égard, les villes et leurs aménageurs sont plus ouverts à la perspective que des sociétés privées. Conclusion : la volonté politique est centrale pour bâtir des villes nourricières. Elle semble d’ailleurs au rendez-vous. La signature à Milan en 2015 par plus d’une centaine de villes et de métropoles situées sur tous les continents d’un « Pacte alimentaire » le souligne. Dans son point 20, le Pacte invite ainsi à « promouvoir et renforcer la production et la transformation de produits alimentaires urbains et périurbains sur la base d’approches durables et à intégrer l’agriculture rurale et périurbaine aux plans de résilience des villes ».
Au-delà, tous les acteurs impliqués doivent avoir une approche écosystémique nouvelle pour intégrer les projets d’agriculture urbaine à la vue des quartiers et villes dans lesquels ils s’implantent, et les connecter aux réalités du monde agricole et de la consommation. L’important n’est
donc pas de systématiser l’agriculture urbaine dans tout projet immobilier mais de le penser en cohérence avec son environnement. C’est un gage évident de pérennité.
A ce titre, Jean-Patrick Scheepers, fondateur de Peas & Love, livre une analyse très juste. « Quand on parle d’agriculture urbaine, la première erreur souvent commise est de ne pas clairement identifier la fonction qu’il faut lui donner dans un projet immobilier. Trop souvent encore, on entend parler de résilience alimentaire, de nourrir les dix milliards d’habitants de la planète en 2050, de l’autonomie des villes et on attribue faussement un rôle à l’agriculture urbaine dans cette problématique. Or ce n’est pas du tout le cas !
Une mauvaise identification de la fonction de l’agriculture urbaine dans un projet peut donc mener à une impossibilité de la mettre en œuvre in fine et rendre le projet caduc dès le départ. Un autre point à ne pas oublier quand on parle d’agriculture urbaine, c’est le temps qu’il faut pour mettre un projet en place. Nous sommes confrontés à deux rythmes lents et longs, l’immobilier et l’agriculture.
Il faut donc du temps pour que les villes changent et que nous le constations ! », écrit-il dans un article publié en janvier 2019.
La rentabilité des projets en question
Et une fois pris en considération tous ces vecteurs de réussite, reste une problématique centrale : celle de modèles économiques qui puissent être pérennisés.
« La viabilité des fermes urbaines, dépend de modèles économiques distincts des modèles agricoles traditionnels où les revenus proviennent essentiellement de la vente de produits alimentaires, analyse ainsi Véronique Saint-Gès. Selon notre enquête, réalisée en 2017, 76% des fermes urbaines développent un modèle de pluriactivités entre production-vente de biens (alimentaires ou équipements agricoles) et services tels que l’installation, l’entretien de fermes urbaines, la formation aux nouvelles pratiques agricoles ou au jardinage au sein des entreprises ou dans les quartiers, l’animation d’ateliers pédagogiques pour les enfants et/ou thérapeutiques, entretien des espaces verts par des moutons ». Et d’ajouter, « la capacité à créer des partenariats avec la formation, les collectivités, les secteurs de la distribution, de la construction ainsi qu’avec la restauration ou la transformation sont autant de points nécessaires à la durabilité des fermes urbaines. Toutefois, reste à améliorer les conditions d’emploi, à penser éco-conception, sources potentielles de productivité et rentabilité. »
Il faut à notre avis ajouter que les initiatives d’agriculture urbaine sont plus rentables et plus robustes quand elles s’inscrivent dans un cadre d’écosystème vertueux, ou des synergies sont trouvées avec les autres acteurs locaux, qu’ils sont d’agriculture urbaine ou non.
Certes, une étude publiée dans Earth’s Future estime que la réduction de transport et de consommation d’énergie, le rafraîchissement de l’air, l’isolation des bâtiments ou la dépollution garantis par l’agriculture urbaine pourraient faire économiser entre 75 et 150 milliards d’euros par an. Les projets pourraient donc être rémunérés aussi en fonction des services rendus à la collectivité.
De plus en plus d’exploitations urbaines tendent vers des productions à forte valeur ajoutée avec ou sans transformation. Cela demande une infrastructure plus couteuse sur moins de surface comparativement à un modèle d’agriculture traditionnelle. Elles ont également l’avantage de générer peu de volume et donc d’être facilement intégrée aux flux urbains. Enfin, elles vendent leur production à des niches de consommateurs et souvent directement au client final. Ces derniers achètent généralement ces produits spécifiques via internet. Ces modèles à l’échelle locale (quelque kilomètres) complètent l’offre nationale et internationale.
Mais en attendant, la seule production/vente directe ne suffit pas à faire vivre un projet sauf à ce qu’il soit subventionné ou dans le cas d’exploitations de très grandes surfaces comme en témoignent les fermes Lufa au Canada ou la ferme d’aquaponie BIGH en Belgique.

Il faut donc miser sur un modèle hybride d’un côté et sur le fait que le consommateur peut accepter un surcoût raisonnable pour des produits locaux, saisonniers et bio. Puis innover. A cet égard, la culture en toiture sous serres et l’aquaponie sont des pratiques prometteuses. Dans le cas des cultures sous serre, pratique très courante au sol, la chaleur fatale du bâtiment peut être utilisée pour chauffer la serre, et l’air du bâtiment, chargé en CO2, peut booster la croissance des plantes. Le projet européen GROOF étudie d’ailleurs cette pratique.
Par ailleurs, le bâtiment peut parfois offrir l’espace suffisant pour transformer et vendre des produits sur place, un bon moyen de diversifier le activités d’un projet d’agriculture urbaine.
« Pour un projet sur lequel nous sommes engagés, nous avons imaginé la production dans les étages : des tomates, salades et autres végétaux dans des fermes aquaponiques, mais aussi de la spiruline fraîche, une microalgue « superaliment » particulièrement recommandée pour ses apports nutritionnels (toutes les vitamines sauf la vitamine D, tous les acides aminés essentiels, des antioxydants, des minéraux…). Nous avons également dédié de la surface en étage à la transformation. L’idée étant ensuite de vendre ces produits bruts ou transformés, soit en direct via des kiosques en rez-de-chaussée, soit dans le cadre d’un service de livraison à vélo accessible aux consommateurs comme aux restaurateurs, raconte Antonin Baigts. Et pour que l’immeuble devienne un véritable lieu de destination, nous souhaitons aussi aménager un mur d’escalade ou une salle de yoga. Bon pour le coeur et le corps, c’est notre approche programmatique pour ce projet ».
Peu à peu donc, les projets d’agriculture urbaine se solidifient. Mais reste une donne à ne pas sous-estimer pour changer de paradigme territorial, celle du lien à reconstruire entre ville et campagne, entre espace dans la ville et espace péri-urbain.
« Le lien entre ville et campagne doit être recréé ou renforcé. Une logique de développement durable suppose une synergie entre les territoires, assure Hugo Meunier, fondateur de Merci Raymond. pour impulser une réelle dynamique autour de l’agriculture urbaine, celle-ci doit être accompagnée du développement de partenariats entre agriculture traditionnelle et centres urbains. Partage de savoir-faire, débouchés économiques pour les producteurs en pleine terre, soutien des projets d’agriculture urbaine… de nombreuses réciprocités entre ville et campagne sont encore à créer ! ».